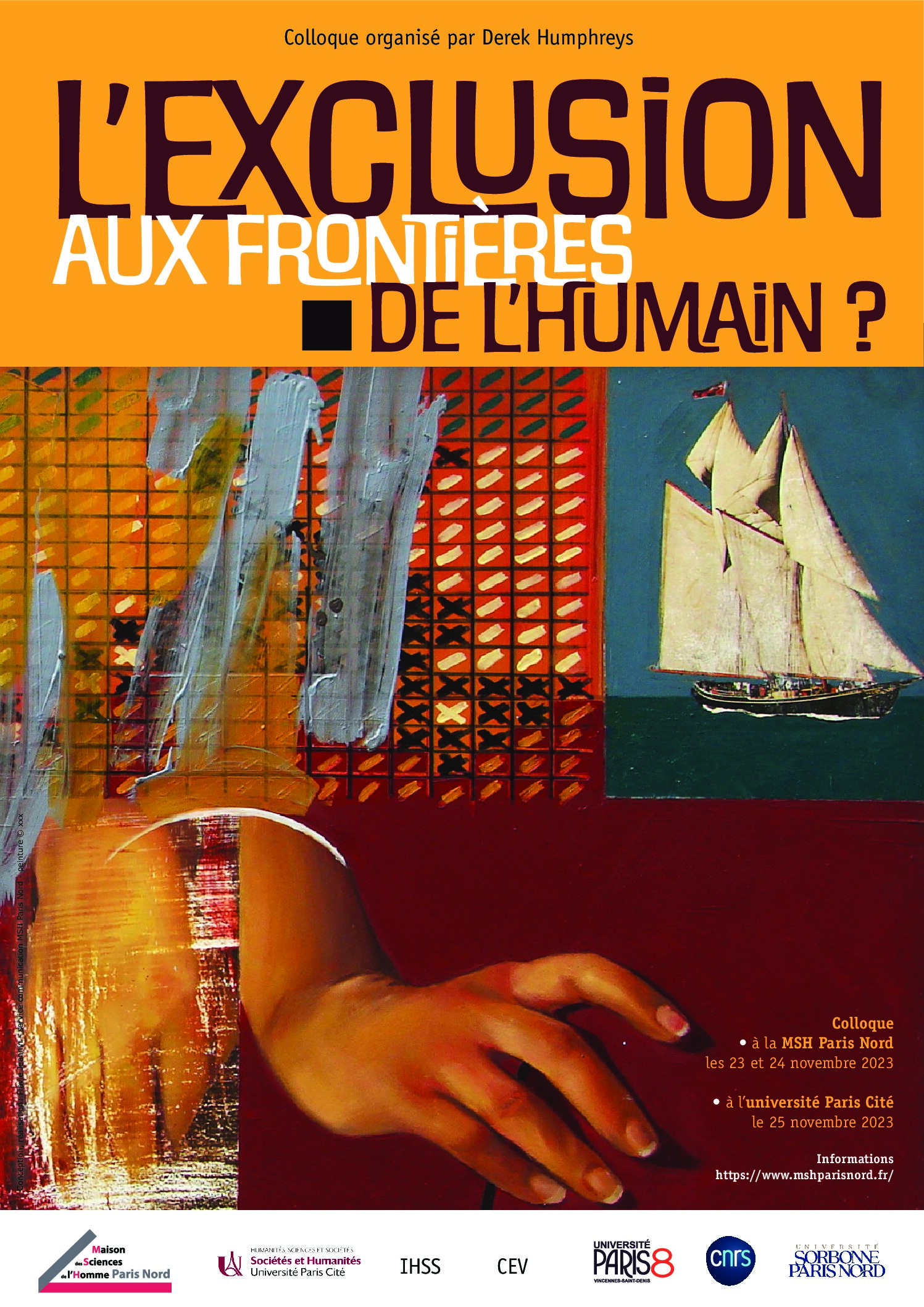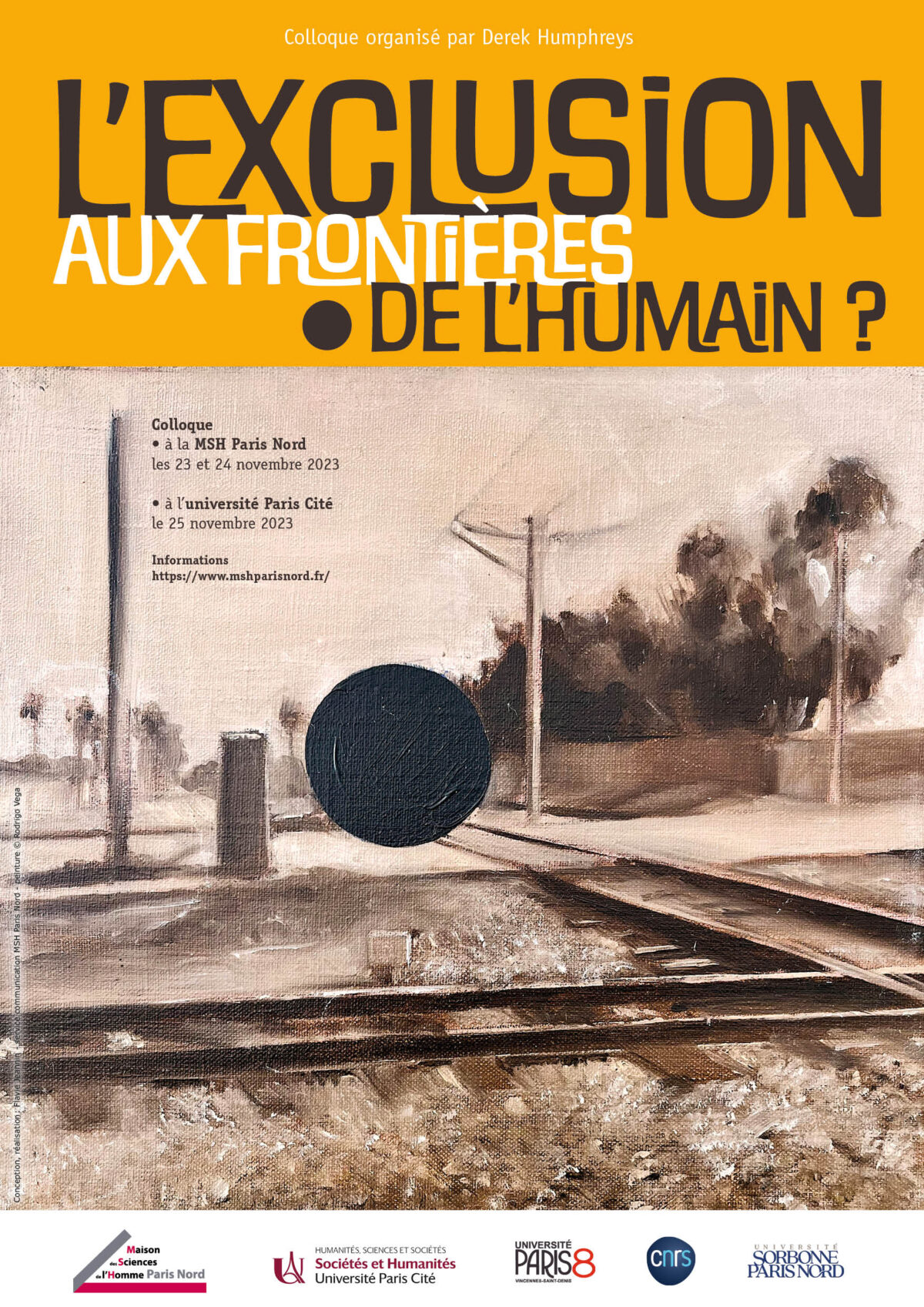Les humanités à l’épreuve de la précarité et des crises migratoires
Les situations d’exclusion, dans lesquelles certaines personnes sont coupées des circuits habituels d’échange qui constituent le tissu social, sont de plus en plus fréquentes et constituent un problème contemporain majeur, tant d’un point de vue individuel que collectif. Conséquence de transformations économiques, de crises politiques, de catastrophes naturelles, de changements sociaux ou de ruptures individuelles, cette évolution est souvent associée à des mouvements migratoires qui accentuent le sentiment d’altérité qui caractérise l’exclusion.
L’idée même d’exclusion interroge les limites de l’humain. Les humains sont des êtres sociaux qui développent des stratégies collectives. L’humanité, l’ensemble des individus qui partagent les comportements dits “humains”, par opposition aux “inhumains”, développe un ensemble de représentations culturelles qui organisent la vie sociale. Comment comprendre alors le processus par lequel certains individus ne sont plus reconnus comme humains ? Quel processus collectif les rend invisibles dans l’espace public ? Pourquoi, au contraire, l’intimité exposée dans l’espace public est-elle ressentie comme une manifestation insupportable du déshumain ? S’agit-il d’un processus individuel aux effets collectifs, ou d’un processus collectif qui détermine certains comportements individuels ? Et quels seraient les effets subjectifs et collectifs de l’exclusion ?
Les manifestations de l’exclusion affectent à la fois le fonctionnement social et les processus psychologiques individuels qui déterminent les relations à la base même de ce que l’on peut appeler l’humain, et leur compréhension doit prendre en compte les aspects anthropologiques, sociologiques, économiques, esthétiques, politiques, historiques, juridiques, psychologiques et philosophiques. Les sciences humaines et sociales, les “humanités”, sont invitées à intervenir dans ce domaine. La tendance spontanée de chaque discipline conduirait à la construction d’une théorisation et d’une stratégie d’intervention basée sur ses propres paradigmes autour, par exemple, de la précarité, de la migration, de la reconnaissance sociale, de l’errance ou de la pauvreté. Or ce type de situation, qui interroge les sciences humaines dans leur ensemble, nous rappelle à quel point la force de ces dernières réside dans leur capacité à construire des stratégies transversales qui prennent en compte la complexité qui caractérise les processus humains. De ce point de vue, même si la notion d’exclusion peut sembler problématique, elle est proposée comme point de départ d’un travail visant à dépasser chaque champ disciplinaire spécifique dans l’élaboration d’un vocabulaire commun.
À travers ce colloque de trois jours, nous proposons d’ouvrir la problématique de l’exclusion en partant des questions théoriques que se posent des jeunes chercheurs en sciences humaines et sociales, ainsi que des pratiques actuellement développées, souvent dans les marges des institutions, par certains collectifs de praticien.ne.s travaillant avec des mineurs isolés, des migrants, des personnes vivant dans la grande précarité dans les rues des grandes villes, parfois associées à des addictions ou à d’autres formes de souffrances psychiques. Nous espérons que ce travail de défrichage de nos pratiques communes nous permettra d’établir un terrain sur lequel construire une stratégie à long terme pour comprendre, analyser, intervenir et évaluer ces problèmes.
Vous pouvez télécharger une version PDF du programme ou cliquer ici pour aller au site du colloque
Programme de la soirée de recherche doctorale, jeudi 23 nov. « Les humanités à l’épreuve de la précarité et des crises migratoires » , Salle Panoramique (4ème étage) de la Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord, 20 Av. George Sand (Métro Front Populaire, ligne 12)
15.30 – Accueil des participants
15.45 – Table ronde « ruptures, errances : les formes de l’exclusion. Discutants : Laura Tichené (Sorbonne Paris Nord), Felipe Saavedra (Sorbonne Paris Nord) et Derek Humphreys (Université Paris Cité)
La situation d’exclusion et la souffrance psychique des peuples autochtones au Brésil, Cécilia Rodrigues. École doctorale Érasme, UTRPP, Université Sorbonne Paris Nord & Universidade de São Paulo USP
L’exclusion et l’exil chez les personnes LGBT+, Yu HU. École doctorale Recherches en Psychanalyse et Psychopathologie, CRPMS, Université Paris Cité. Psychologue clinicienne à l’ARDHIS – Association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et trans à l’immigration et au séjour
Les hommes gays, une exclusion quant à leur parentalité ? Aikaterini Riga. École doctorale Érasme, UTRPP, Université Sorbonne Paris Nord
* * *
17h – Table ronde « précarités, exils, migrations ». Discutants : Nicolas Schwalbe (Sorbonne Paris Nord), Marlon Miguel (Bauhaus Universität Weimar) et Nicolas Robert (Aix Marseille Université)
Estamira : la caméra devant la précarité. Kéren Alcântara, École doctorale Érasme, UTRPP, Université Sorbonne Paris Nord
L’étranger ou le réfugié vu comme danger. Cécile HOUSSET, Doctorante en philosophie politique, ED 624. Laboratoire PHILéPOL, Université Paris Cité
Point(s) de départ. Elida Kocani, Sociologue diplômée en « Santé, société et migration », responsable des programmes « accès aux droits et inclusion sociale », GRDR Migration-Citoyenneté-Développement
18h – Mots de clôture et pot convivial
Vendredi 24 novembre.
Humaine, la rue ? Dans les marges, se battre contre l’invisibilité. Auditorium de la Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord (1er étage) 20 Av. George Sand, Métro Front Populaire, ligne 12
9h. Accueil
Présidente de séance de la matinée : Dominique Mazéas (CRPMS, Univ Paris Cité)
9.30 – 10.45 Première table. Diversité clinique et pratiques spatiales en rue. Alexandra Barrière, éducatrice spécialisée. Service de prévention sociale. Association CASP ; Marie Mourez, assistante de service sociale. Unité d’Assistance aux Sans-Abri (UASA). Ville de Paris ; Julie Lafont, éducatrice spécialisée. Amicale du nid – équipe mineur.es 13 ; Mélanie Fakheur, docteur en psychologie. Psychologue clinicienne, Amicale du nid – équipe mineur.es 13 ; Nicolas Robert, docteur en psychologie. ATER, Aix-Marseille Université
11.15 – 12.30 Deuxième table. Au coeur des ténèbres, l’horreur absurde. Elizaveta Axentiuc, psychologue, équipe mobile Bociek (Charonne-Oppelia) & ESPEREM ; Carmen Azar, psychologue clinicienne, équipe mobile Bociek et EMI SUD (Charonne-Oppelia) ; Muriel Bamberger, psychologue clinicienne, Comité pour la santé des exilés (COMEDE) ; Sara D’Andrea, psychiatre, Centre Minkowska ; Juan Rodriguez, psychologue clinicien, ASSORE (association Aurore) ; Olga Smirnova, psychologue clinicienne, CSAPA CICAT28 et équipe mobile Bociek ; Claude Pawlik, docteur en psychopathologie clinique. Psychologue de l’équipe Bociek et CJC (Charonne-Oppelia) ; Martin Lamadrid, psychologue clinicien, SOS Groupe-HUDA. Doctorant Univ Sorbonne Paris Nord.
Présidente de séance de l’après-midi : Hakima Megherbi (UTRPP, Univ Sorbonne Paris Nord)
13.30 – Penser, Camérer avec Fernand Deligny. Marina Vidal-Naquet (Université Paris Nanterre) et Martin Molina Gola (Université Paris 8)
14h – 15.15 Troisième table. Inventer dans les marges des institutions : legs de la psychothérapie institutionnelle. Keren Alcantara, psychologue, doctorante Univ Sorbonne Paris Nord / UTRPP ; Camille Buchon, psychologue, animatrice au GEM de St-Denis ; Adèle Larvoire, psycho-sociologue ; Benjamin Penet, cinéaste, animateur au GEM St-Denis ; Felipe Saavedra, psychologue, doctorant Univ Sorbonne Paris Nord / UTRPP ; Nicolas Schwalbe, doctorant Univ Sorbonne Paris Nord / UTRPP
15.45 – 17 Quatrième table. Esbarrão et mafuá: expériences clinico-politico-médiatiques de la Casa Jangada, Rio de Janeiro. Cezar Migliorin, psychanalyste, professeur au département de cinéma, Univ Fédéral Fluminense » ; Marlon Miguel, philosophe, co-responsable du programme « Madness, Media, Milieus. Reconfiguring the humanities in postwar Europe », Bauhaus Universität Weimar ; Élise Pestre, psychanalyste, maître de conférences, département d’études psychanalytiques, université Paris Cité ; Bruna Pinna, psychologue clinicienne, Casa Jangada, Brésil ; Elena Vogman, philosophe, co-responsable du programme « Madness, Media, Milieus. Reconfiguring the humanities in postwar Europe », Bauhaus Universität Weimar
« L’exclusion aux frontières de l’humain » Symposium du samedi 25 novembre – Amphithéâtre Buffon 15 rue Hélène Brion, Paris 13ème, campus Grands Moulins Métro Bibliothèque (ligne 14), Arrêt Avenue de France (Tram 3a)
Présidente de séance de la matinée : Monique David-Ménard
9h. Mot d’accueil. Derek Humphreys. Les humanités pour penser l’exclusion, les limites de l’humain.
9.30-10.45
Dominique Versini. Le Samu social 30 ans après : de l’aller vers ceux qui ne demandent plus rien à la crise de l’accueil des réfugiés ?
Guillaume Le Blanc. Rendre visibles les vulnérabilités.
11.15-12.30
Astrid Deuber-Mankowsky. Displacement vs. Mobility or who owns the world. An Aesthetic Inquiry into Infrastructure, Common Possession, and Violence in Karim Aïnouz’s Documentary Film Central Airport THF(2017).
François Pommier. De l’exclusion à la création d’un espace transférentiel.
Pause déjeuner
Présidente de séance de l’après-midi : Pascale Molinier
14-15.15h
Catherine Perret. Inclure/exclure : comment sortir de l’impasse institutionnelle ?
Patrick Cingolani. Précarité, pauvreté : du welfare au warfare ?
15.45-17h
Olivier Douville. L’exclusion : au-delà de la séparation, l’abandon. Reconstruire une altérité plausible.
Claudia Girola. Tenir malgré tout : crise de la présence et expérience temporelle dans une vie incertaine
17h. Conclusions de la journée et perspectives pour une approche interdisciplinaire.
Monique David-Ménard, Pascale Molinier et Derek Humphreys.
INTERVENANTS
Patrick Cingolani. Sociologue, professeur émérite, membre du laboratoire du changement social et politique (LCPS), université Paris Cité.
Monique David-Ménard. Psychanalyste et philosophe, Membre fondatrice de la société internationale de psychanalyse et philosophie.
Astrid Deuber-Mankowsky. Philosophe, professeure émérite de théorie des média, université de Bochum-Ruhr.
Olivier Douville. Psychanalyste, chercheur associé au CRPMS. Membre d’honneur du collège international psychanalyse et anthropologie.
Claudia Girola. Anthropologue. Maîtresse de conférences en sociologie et anthropologie, membre du laboratoire de changement social et politique (LCSP), université Paris Cité.
Guillaume Le Blanc. Philosophe, professeur de philosophie sociale et politique, co-directeur du laboratoire du changement social et politique (LCPS), université Paris Cité.
Pascale Molinier. Professeure de psychologie sociale, membre de l’unité transversale de recherche en psychogenèse et psychopathologie (UTRPP), université Sorbonne Paris-Nord.
Derek Humphreys. Professeur au département d’études psychanalytiques – CRPMS, université Paris Cité. Directeur du centre d’études du vivant.
Catherine Perret. Psychanalyste. Professeure de philosophie, laboratoire art des images et art contemporain (AIAC), université Paris 8.
François Pommier. Psychanalyste et Psychiatre. Professeur émérite, université Paris Nanterre.
Dominique Versini. Cofondatrice du Samu Social, ex. secrétaire d’Etat et maire adjointe de Paris chargée de la lutte contre l’exclusion et de l’accueil des réfugiés.